Alors que la recherche sur la prévision météorologique et climatique s’enrichit des apports du deep learning, offrant des traitements de données plus fins et complexes, l’essor du photovoltaïque exige des outils numériques toujours plus performants pour optimiser la valorisation de l’énergie produite et son intégration dans les réseaux et modèles économiques existants. Sur le campus de l’École polytechnique à Palaiseau, les équipes de recherche, appuyées par des infrastructures de pointe et des financements publics, cherchent désormais à renforcer leurs liens avec le monde industriel. Objectif : faire converger innovations scientifiques et besoins concrets du secteur.
C’est dans cette perspective que le Laboratoire de météorologie dynamique (LMD) et FX Conseil ont organisé une journée d’échanges au sein de l’observatoire SIRTA. L’événement a réuni chercheurs, entreprises, représentants de pôles de compétitivité et institutions publiques autour d’un enjeu central : la prévision de la ressource solaire. Échange avec les coordinateurs de l’événement qui s’est déroulé le 04 avril dernier.
- Sylvain Cros est ingénieur de recherche au Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD), une unité mixte de recherche rattachée à l’ENS, Sorbonne Université et l’École polytechnique, où l’équipe travaille notamment sur la modélisation du potentiel solaire et éolien,
- Georges Favre est responsable du développement de FX Conseil, la structure chargée de valoriser la recherche de l’École polytechnique en accompagnant les laboratoires dans leurs collaborations avec les acteurs industriels.
pv magazine France : Nous sommes aujourd’hui à l’observatoire SIRTA. Pouvez-vous nous en dire quelques mots et expliquer pourquoi vous avez choisi ce lieu pour organiser cette rencontre ?
Sylvain Cros : L’Observatoire de recherche atmosphérique SIRTA est ce que l’on appelle un « super site ». Il se distingue par un équipement scientifique exceptionnel : plus de 150 instruments y sont installés pour mesurer quasiment tous les paramètres atmosphériques – la météo, l’humidité, la pluviométrie, le rayonnement solaire, la vitesse du vent, entre autres. À l’échelle mondiale, seuls une vingtaine de sites de ce type existent. Le SIRTA fait partie d’un réseau international d’observation au service des climatologues et des météorologues.
Nous avons choisi ce lieu pour plusieurs raisons. D’une part, il est situé sur le campus de l’École polytechnique, dans un bâtiment récent doté d’une salle de conférence moderne et bien équipée. D’autre part, ce lieu symbolise à nos yeux le renouveau de la donnée climatique, météorologique et son exploitation scientifique et technologique.
Georges Favre : J’ajouterais que ce choix s’inscrit aussi dans une volonté affirmée — et déjà en partie concrétisée — de renforcer les collaborations entre le monde académique et les entreprises. Le LMD travaille depuis longtemps avec des partenaires industriels afin de transférer son expertise et de faire progresser les connaissances. Dans le cadre spécifique de la prévision des ressources solaires, le SIRTA joue un rôle stratégique. Il abrite non seulement des instruments de pointe, mais également plusieurs démonstrateurs, dont une ferme agrivoltaïque. Celle-ci nous a semblé particulièrement pertinente pour enrichir les échanges de la journée. Elle illustre concrètement les thématiques explorées par les laboratoires de l’École polytechnique autour de l’énergie solaire, tout en offrant aux participants la possibilité de visiter les installations et de mieux comprendre les enjeux traités.

Image : MB
Quel était l’objectif principal de cette journée de conférence ? Et quelles sont vos premières impressions à chaud ?
GF : L’objectif principal était de renforcer le lien entre les laboratoires de l’École polytechnique et les acteurs du monde socio-économique. Il ne s’agissait pas uniquement d’entreprises : nous avons également accueilli des représentants de pôles de compétitivité, du Comité stratégique de filière, et d’autres structures impliquées dans l’écosystème de la transition énergétique. L’idée était de favoriser un continuum entre la recherche académique et les décideurs ou utilisateurs finaux de ces connaissances dans le monde économique. Le sujet central de cette journée — la prévision de la ressource solaire — est, à notre sens, un enjeu majeur pour la filière.
Le fait d’avoir réuni sur place des experts issus à la fois du monde académique et de l’industrie a permis d’enrichir les discussions. Chacun a pu apporter son regard, ses contraintes, ses perspectives. Cela ouvre des pistes pour de futurs développements, qu’ils soient collaboratifs ou complémentaires. Nous avons aussi commencé à réfléchir à la manière dont les différents acteurs — pôles de compétitivité, instances de filière, régulateurs — pourraient s’organiser à l’avenir pour faire progresser ensemble cette thématique.
SC : Il y a aussi un contexte historique à ne pas négliger. Jusqu’à présent, le développement de l’industrie photovoltaïque et les recherches en météorologie appliquée à l’énergie ont avancé de manière relativement parallèle et bien synchronisée. Mais aujourd’hui, avec la montée en puissance du solaire, les travaux de recherche, parfois anciens, prennent une nouvelle valeur. Ils commencent à être exploités de manière plus concrète et à grande échelle. Ce type de journée permet justement de rapprocher ces deux univers (la recherche et l’industrie) et de mettre en lumière des résultats tangibles.

Nous avons particulièrement apprécié que des entreprises viennent témoigner de l’utilité des prévisions météorologiques dans leurs activités, en quantifiant les bénéfices. Pour nous, chercheurs, c’est précieux : cela nous aide à mieux positionner nos travaux et à comprendre leur impact réel. Et pour les industriels, c’est aussi l’occasion de découvrir que beaucoup de données et de résultats restent encore inexploités. Il y a un véritable potentiel, et l’intérêt manifesté par les acteurs économiques est fort. Enfin, il est important de souligner que cette journée s’inscrivait dans une dynamique de continuité. Elle marque une étape supplémentaire dans une démarche plus large de mise en synergie entre recherche, innovation et besoins industriels.
Vous avez également accueilli la Task 16 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) cette semaine, avant l’événement d’aujourd’hui. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
SC : L’AIE coordonne de nombreux programmes, dont celui sur l’énergie solaire [le programme Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS)], lancé il y a une vingtaine d’années, bien avant que les applications industrielles ne prennent l’ampleur qu’on connaît aujourd’hui. La Task 16 de l’AIE PVPS [ie. Ressource solaire pour les applications à forte pénétration et à grande échelle] réunit des chercheurs du monde entier pour définir des bonnes pratiques scientifiques et faciliter l’usage des données solaires par les industriels. Ce groupe de travail assure un échange constant entre des laboratoires du monde entier, permettant à chacun de rester informé des avancées internationales. Pour nous, au LMD, cette participation est essentielle : elle nous permet de suivre de près l’état de l’art en matière de prévision solaire et de nourrir nos travaux avec les dernières expertises.
GF : Ce groupe compte également des représentants du monde industriel, investis au côté des chercheurs académiques. L’un des enjeux est aussi de mieux faire connaître ce groupe (la Task 16) auprès des acteurs français qui n’en font pas encore partie. Il est important de les informer sur ce qui s’y fait, voire de les inciter à s’y impliquer. Cela permettrait de renforcer la présence française dans ces instances internationales, où nous sommes parfois encore peu coordonnés — un constat qui ne concerne pas uniquement le domaine de la prévision solaire.
SC : Lors de cette session, nous avons accueilli une quarantaine de participants sur place et une soixantaine en ligne, avec des contributions venues d’Europe, d’Amérique du Nord, de Chine et d’Afrique du Nord. La Task 16 rassemble une diversité d’acteurs, avec une forte présence des pays germanophones et scandinaves. La France y est représentée, mais il reste un enjeu à renforcer notre coordination et notre participation dans ce réseau international. Récemment, le groupe a publié un document majeur : le Handbook, un guide de référence sur les bonnes pratiques pour l’utilisation de la ressource solaire.
Ce contenu est protégé par un copyright et vous ne pouvez pas le réutiliser sans permission. Si vous souhaitez collaborer avec nous et réutiliser notre contenu, merci de contacter notre équipe éditoriale à l’adresse suivante: editors@pv-magazine.com.






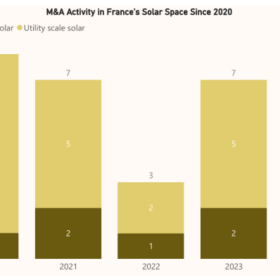
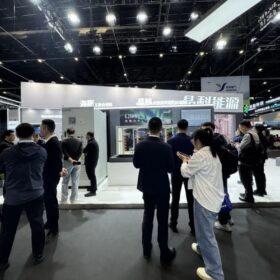
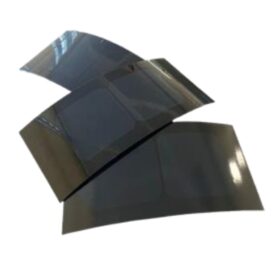
En transmettant ce formulaire vous acceptez que pv magazine utilise vos données dans le but de publier votre commentaire.
Vos données personnelles seront uniquement divulguées ou transmises à des tierces parties dans une optique de filtre anti-spams ou si elles s’avèrent nécessaires à la maintenance technique du site web. Un transfert de vos données à des tierces parties pour toute autre raison ne pourra se faire que s’il est justifié par la législation relative à la protection des données, ou dans le cas où pv magazine y est légalement obligé.
Vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment avec effet futur, auquel cas vos données personnelles seront immédiatement supprimées. Dans le cas contraire, vos données seront supprimées une fois que pv magazine aura traité votre requête ou lorsque le but du stockage des données est atteint.
Pour de plus amples informations sur la confidentialité des données, veuillez consulter notre Politique de Protection des Données.